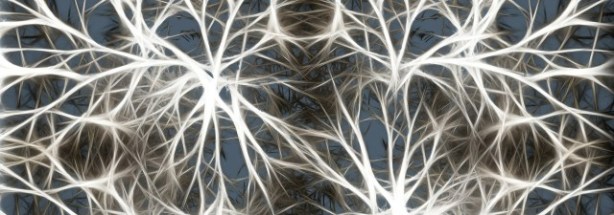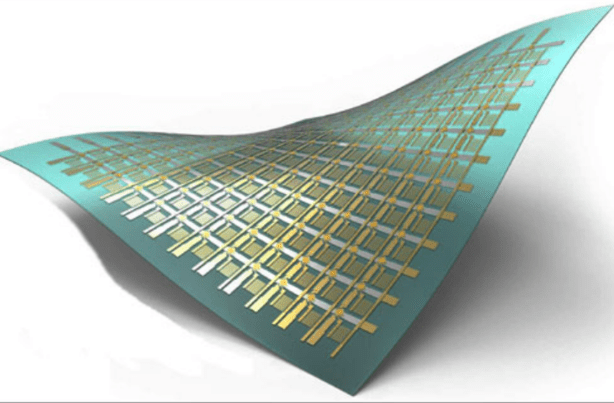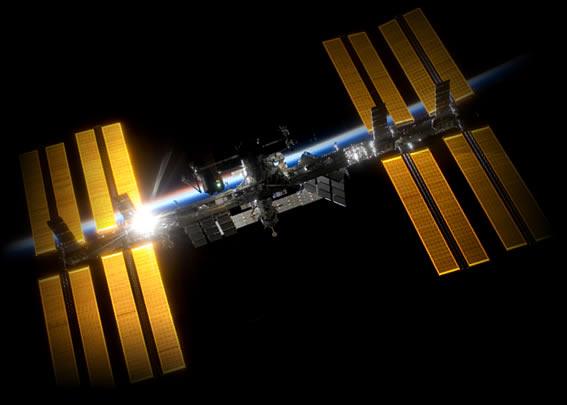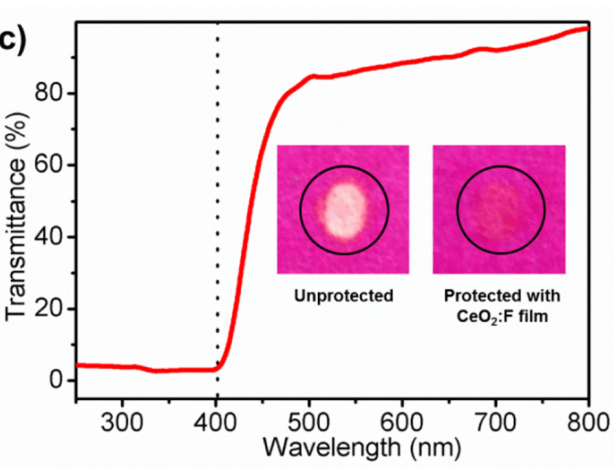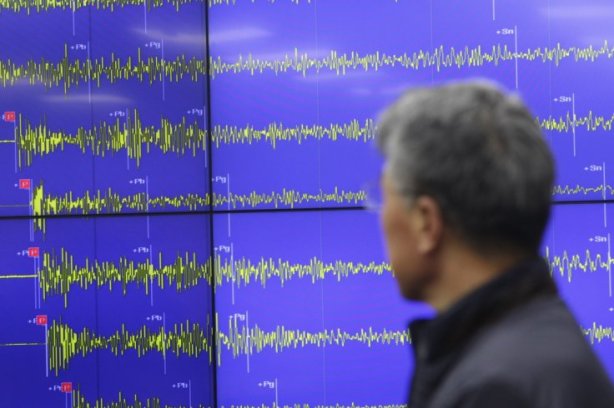iRobot, tout le monde connait – en particulier par son robot aspirateur Roomba autonome, l’un des meilleurs modèles du marché, et un précurseur dans son domaine. Mais iRobot, c’est moins connu, c’est également une société de robotique militaire. C’est cette dernière activité qui vient d’être cédée au groupe Arlington Capital Partners, pour 45 millions de $.
La division militaire d’iRobot développe des robots d’exploration comme le 110 FirstLook (voir ci-dessous), un robot de reconnaissance léger, robuste, capable d’effectuer des missions de reconnaissance NRBC, de vérification de véhicule ou d’exploration d’un environnement rendu complexe par la présence de fumées, ou de débris.

A l’autre extrémité du spectre, on peut également citer le robot 710 Kobra, capable de grimper des escaliers et de réaliser des missions de déminage sur tout terrain, par tous les temps. Ces robots sont fondés sur un socle commun : deux chenilles, une plate-forme capable d’héberger différentes charges utiles, et un second couple de chenilles (amovibles) sur l’avant, permettant de monter des escaliers ou d’escalader des obstacles.

La cession de sa division militaire a pour objectif de permettre à iRobot de se consacrer totalement au domaine de la robotique grand public. La nouvelle société issue de l’opération et détenue à 100% par des capitaux privés sera donc totalement dédiée au monde de la défense et de la sécurité. Son directeur général sera Sean Bielat, un ancien officier des US Marines.
Cette annonce a au moins le mérite de clarifier les intentions de la société dans le domaine de la robotique militaire. D’autres entités, comme Boston Dynamics, ont des stratégies moins claires : rachetée par Google en décembre 2013, cette dernière société, créatrice de robots célèbres comme « Alpha Dog » ou « Cheetah » n’a toujours pas précisé sa stratégie dans le monde de la défense. Malgré les intentions de Google de « stopper tout développement de Boston Dynamics dans le militaire » (une posture dictée par une volonté d’affichage vers le grand public), les contrats de développement avec le DoD américain se poursuivent. Et l’on ne compte plus les sociétés de robotique achetées par Google (aujourd’hui Alphabet) : Meka, Redwood Robotics, Schaft, Industrial Perception, … sans compter ses développements dans les véhicules autonomes.
Mais le débat sur Google et la robotique est biaisé par les SALA (systèmes d’armes létaux autonomes), un concept qui pollue en fait la totalité du débat sur la robotique militaire. Il suffit de regarder les activités de iRobot, de Nexter Robotics ou de Tecdron pour constater que la robotique militaire, c’est aujourd’hui autre chose que des systèmes d’armes. Bon, même si iRobot avait déjà fait des essais d’armement de son robot 710 avec le concours de Metal Storm.

Compte tenu de l’historique dans le domaine, nul doute que la DARPA constituera une source de financement importante pour la nouvelle société issue d’iRobot. Car les défis sont loin d’être résolus aujourd’hui : un robot a encore du mal à ouvrir une porte ou évoluer de manière complètement autonome dans un environnement non structuré, complexe et changeant.
Le nom de la nouvelle société sera révélé à l’issue de la transaction, dont la phase légale doit encore durer 90 jours.